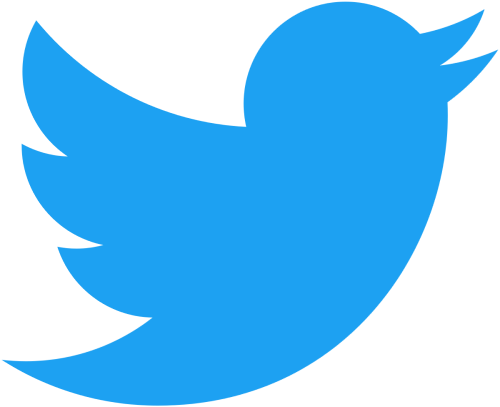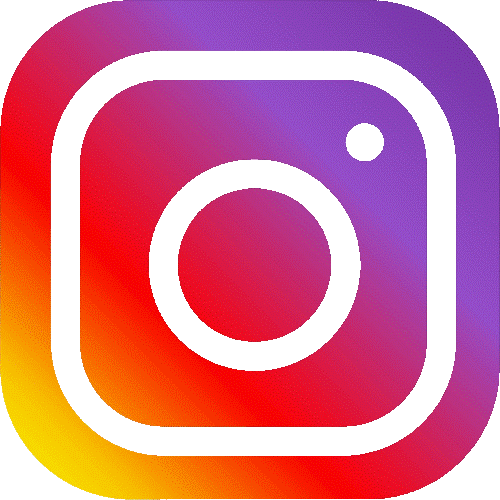Anatomie & Ostéopathie
A. Chantepie et J.-F. Pérot
CARACTÉRISTIQUES
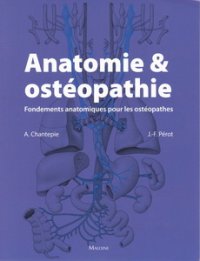
Date de parution : 2015
Éditeur : Maloine
ISBN : 9782224030292
Nb. de pages : 224 pages
Dimensions : 195 x 255 mm
Prix broché : 53,00 €
Descriptif
L’anatomie étudie la structure, la topographie et le rapport des organes du corps entre eux, chez tous les êtres vivants.
 L’ostéopathie fondée par A.T. Still (1828-1917) est une méthode de traitement manuel des restrictions de mobilité qui peuvent a_ ecter l’ensemble des structures du corps humain ; ces restrictions ou dysfonctions pouvant entraîner à leur tour des déséquilibres perturbateurs de l’homéostasie, et altérer l’état de santé général. L’ostéopathie fait appel à une connaissance approfondie de l’anatomie et comme le soulignait A.T. Still : « L’ostéopathie c’est d’abord de l’anatomie, encore de l’anatomie, toujours de l’anatomie » ; « Un ostéopathe raisonne à partir de ses connaissances en anatomie ».
L’ostéopathie fondée par A.T. Still (1828-1917) est une méthode de traitement manuel des restrictions de mobilité qui peuvent a_ ecter l’ensemble des structures du corps humain ; ces restrictions ou dysfonctions pouvant entraîner à leur tour des déséquilibres perturbateurs de l’homéostasie, et altérer l’état de santé général. L’ostéopathie fait appel à une connaissance approfondie de l’anatomie et comme le soulignait A.T. Still : « L’ostéopathie c’est d’abord de l’anatomie, encore de l’anatomie, toujours de l’anatomie » ; « Un ostéopathe raisonne à partir de ses connaissances en anatomie ».
Les auteurs, s’inscrivant dans la lignée de l’ostéopathie anglo-saxonne, font le lien entre anatomie et concept ostéopathique du fonctionnement de la mécanique humaine.
Cet ouvrage a l’ambition de proposer un abord de l’anatomie humaine permettant la compréhension des rapports des différentes structures entre elles. Les nombreuses illustrations inédites, la distribution et la répartition innovante des modules étudiés permettent au lecteur d’appréhender l’anatomie d’une façon pragmatique et justifiant les traitements ostéopathiques.
A. Chantepie et J.-F. Pérot sont les auteurs des classiques « Cahiers d’ostéopathie » en 8 volumes.
Préface
La connaissance de l’anatomie est une base incontournable du diagnostic et du traitement.
Son enseignement, le plus souvent et naturellement confié aux chirurgiens, a perdu du terrain dans les facultés face aux nouvelles approches de la santé : socio-économique, statistique, éthique. Il est vrai qu’il est plus agréable de s’initier à l’anatomie dans les musées que dans les salles de dissections ou les bibliothèques. On croyait l’anatomie descriptive figée et sclérosée ! Les nouvelles techniques thérapeutiques nous imposent de la redécouvrir et toujours la réapprendre !
L’imagerie offre une approche diagnostique de plus en plus dynamique (échographie, IRM), l’endoscopie permet la description des variantes physiologiques ou pathologiques dont l’intérêt était sous-estimé en dissection. L’analyse fonctionnelle en kinésithérapie et ostéopathie est un complément indispensable à la compréhension physiologique.
Plus globalement, diagnostics et soins ne peuvent être moins invasifs qu’à la condition de « maîtriser » les connaissances en anatomie.
Si les radiologues la numérisent, les « manuels » que sont les chirurgiens, kinésithérapeutes et ostéopathes, la connaissent et la pratiquent « du bout des doigts » !
Très souvent, il est reproché à l’ostéopathie une description « ésotérique » des « liens » anatomiques fondamentaux pour la compréhension des dysfonctions et leurs traitements.
Si orthopédistes et ostéopathes travaillent ensemble depuis des décennies, il faut reconnaître qu’ils utilisent souvent un vocabulaire commun, mais ne se comprennent pas toujours car ils parlent de lésions différentes !
André Chantepie et Jean-François Pérot s’appliquent à enseigner et pratiquer l’ostéopathie avec la rigueur cartésienne qui s’impose. Pour eux aussi, la connaissance anatomique est un impératif constant, indispensable à la description des lésions et leur traitement adapté, permettant d’améliorer les résultats et limiter toute iatrogénie.
Il faut les remercier pour ce remarquable travail sur les liens anatomiques de l’ostéopathie qui doit permettre de mieux comprendre pour mieux soigner.
Dr C. Tallineau,
chirurgien orthopédiste tab Introduction
Introduction
Le corps humain est soumis à des impératifs statiques, à la verticalité et à l’horizontalité du regard et doit être en permanence à la fois mobile et stable, ce qui est contradictoire.
Il doit adapter sa position à la pesanteur, force venant d’en haut, et à la réponse venant du sol. Comme tout corps érigé, il répond aux lois de la gravité.
Pour que le corps soit en équilibre, la projection du centre de gravité du corps humain doit rester au-dessus de son polygone de sustentation. De par sa structure osseuse, le pelvis est le point maximum de rencontre de ces forces : les iliums recevant les forces venant du bas et le sacrum celles venant du haut.
Le corps humain est un empilement de segments articulés dont chaque partie est en équilibre sur la pièce sous-jacente. Lorsqu’un segment doit s’équilibrer, il ne peut le faire qu’à partir du segment du dessous. Ainsi le départ de l’équilibre semble être la réaction du pied sur le sol.
Toutes les dysfonctions articulaires perturbent la posture du corps humain donc inévitablement les lignes de gravité et leur rapport entre elles. Le rapport des différentes lignes mathématiques du corps humain entre elles varie donc constamment en fonction des variations de la posture.
La connaissance de l’anatomie permet de mieux comprendre les variations auxquelles peut être soumis l’équilibre postural de la mécanique humaine.
Cette anatomie que nous nous sommes efforcés de présenter dans cet ouvrage est avant tout une anatomie clinique orientée vers la pratique ostéopathique. Il ne s’agit pas d’anatomie descriptive, pour laquelle le lecteur pourra se référer aux nombreux ouvrages existants, mais d’anatomie avant tout pratique, indispensable à la compréhension des dysfonctions ostéo-pathiques et au traitement des différents tableaux cliniques rencontrés.
L’accent a volontairement été mis sur les éléments essentiels auxquels tout ostéopathe se trouve confronté dans sa pratique quotidienne. Afin de respecter la démarche qui a été la nôtre tout au long de l’écriture des « Cahiers d’ostéopathie », et qui met en avant le concept ostéopathique que nous ont transmis nos maîtres, nous avons sciemment limité les descriptions anatomiques aux structures en rapport avec l’axe craniosacré. tab Table des Matières
Table des Matières
Préface
Abréviations
Introduction
1. Embryogenèse
Introduction
La segmentation
La prégastrulation
La gastrulation
La délimitation
L’organogenèse
2. Crâne et charnière occipitocervicale
Anatomie du crâne
Foramen jugulaire
Fascias et aponévroses
Les méninges
Les nerfs crâniens
Vascularisation
Charnière occipitocervicale
3. Rachis
Pivot iliolombosacré
Rachis lombaire
Rachis thoracique
Charnière thoracolombaire : T12 vertèbre charnière
Rachis cervical
Charnière cervicothoracique
Gril costal
4. Pelvis
La ceinture pelvienne
L’os coxal
Le sacrum
Le coccyx
La jonction lombosacrée
Les articulations sacro-iliaques
La symphyse pubienne
La jonction sacrococcygienne
Le plancher pelvien ou diaphragme pelvien
Innervation
Le contenu pelvien
La ceinture pelvienne et le membre inférieur
5. Système musculaire du tronc
Introduction
Tronc : groupe antérieur
Tronc : groupe postérieur
Le diaphragme
6. Système viscéral<br /> Les parois du caisson abdominal
Le péritoine
La cavité péritonéale
La grande cavité péritonéale
Œsophage abdominal
Estomac
Intestin grêle
Gros intestin
Foie
Vésicule biliaire et voies biliaires
Pancréas
Rate
Glandes surrénales
Appareil urinaire
7. Système circulatoire (artères, veines, lymphatiques)
Circulation générale
Système circulatoire de la pyramide inférieure
Système circulatoire de la pyramide supérieure
8. Innervation
La région craniocervicale
La région thoraco-abdominale
Les nerfs thoraco-abdominaux
Les nerfs phréniques
Les nerfs vagues (X)
Les nerfs splanchniques
Les chaînes sympathiques et les ganglions latéro-vertébraux
Les plexus autonomes neurovégétatifs
Le plexus lombal
Le plexus sacral
Le plexus coccygien
Nerf sinuvertébral (Luschka) et les rameaux dorsaux des nerfs spinaux
9. Axe craniosacré
Organisation de l’axe craniosacré
Les méninges crâniennes
Le core link
Les quatre diaphragmes
Aponévroses et fascias
Facteurs de dysfonction extrinsèque du système craniosacré
10. Tendon central<br /> Constitution
Description
Ses rapports
Mécanique du tendon central
11 Noyaux d’ossification
Le crâne de l’enfant à la naissance
Noyaux d’ossification
12. Hiatus et foramens
Généralités
Foramen intervertébral
Grand foramen ischiatique (canal suprapiriforme et canal infrapiriforme)
Petit foramen ischiatique
Foramen obturé et canal obturateur
Foramen omental
Hiatus diaphragmatique
Hiatus périnéaux
Hiatus urogénital
Fosse ischio-anale et canal pudendal (canal d’Alcock)
Canal inguinal
Triangle fémoral, gaine fémorale et canal des adducteurs
13. Pudendalgie et pubalgie
Le nerf pudendal : sites de conflits
Innervation du périnée
Les nerfs cluniaux
Les muscles pelvitrochantériens
Pubalgies, rappel anatomique
Les douleurs d’origine thoracolombaire
Annexes
Bibliographie
Index.