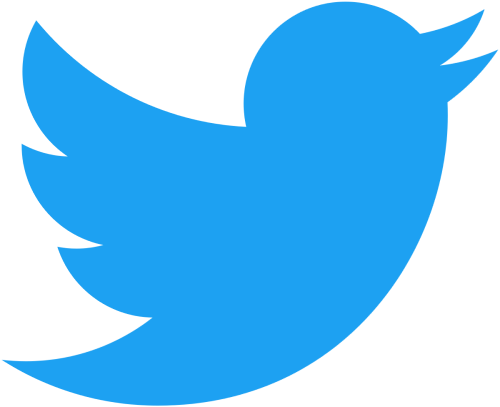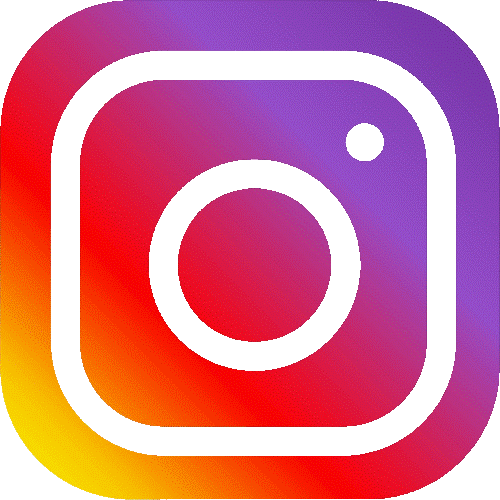La cheville instable
De l’entorse récente à l’instabilité chronique
Yves Tourné, Christian Mabit
CARACTÉRISTIQUES
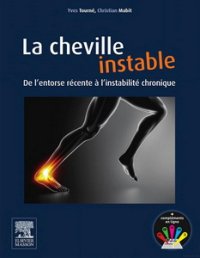
Date de parution : 2015
Éditeur : Elsevier-Masson
ISBN : 9782294714566
Nb. de pages : 376 pages
Dimensions : 210 x 270 mm
Prix relié : 99,50 €
eBook : 64,99 €
Descriptif
Les lésions ligamentaires de la cheville, réputées banales, sont néanmoins parmi les plus fréquentes en traumatologie des membres inférieurs. Cette monographie rassemble de façon exhaustive toutes les données médicales ainsi que les méthodes diagnostiques et thérapeutiques existant sur la cheville instable.
- Les premiers chapitres présentent les connaissances indispensables à maîtriser : les bases anatomiques de la stabilité de la cheville ainsi que la biomécanique et la cinétique de la cheville.
- L’ouvrage aborde ensuite les lésions récentes et chroniques de la cheville. L’approche diagnostique permet de distinguer les instabilités aiguës des instabilités chroniques et répertorie l’ensemble des moyens thérapeutiques, médicaux et chirurgicaux, permettant la meilleure prise en charge.
- L’ensemble de l’ouvrage est didactique : son contenu est parfaitement structuré et richement illustré par des photos, dessins, tableaux et arbres décisionnels et largement étayé par de nombreuses vidéos de techniques innovantes en rééducation, chirurgie et arthroscopie.
- Pratique, le dernier chapitre rassemble l’ensemble des scores d’évaluation nécessaire à l’évaluation clinique.
Cette monographie est la référence en langue française et constitue une aide précieuse permettant d’avoir une approche synthétique du sujet et d’adapter en conséquence la pratique thérapeutique des chirurgiens orthopédistes de l’enfant et de l’adulte, des médecins urgentistes, des médecins du sport, des médecins rééducateurs et des kinésithérapeutes.
Fruit de la collaboration des coordinateurs et d’auteurs référents dans la pathologie de la cheville, ce livre rassemble toutes les données actualisées concernant l’instabilité de la cheville
Les auteurs
Yves Tourné est chirurgien orthopédiste à la clinique des Cèdres à Grenoble, spécialiste en chirurgie du pied et de la cheville.
Christian Mabit est responsable du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU Dupuytren et professeur d’anatomie à la Faculté de médecine de Limoges.
Avant-propos
La Sofcot nous avait confié la direction d’un Symposium sur l’instabilité chronique de cheville pour son Congrès de 2008. Notre réflexion s’était étayée sur une revue clinique de patients, dont le but était l’évaluation à long terme des ligamentoplasties sur le plan clinique, fonctionnel et radiographique : 310 cas de reconstructions capsuloligamentaires avaient pu être analysés, avec un recul moyen de 13 ans, ce qui constituait la série de référence en nombre et recul.
La masse d’informations recueillie et l’absence d’ouvrage thématique sur l’instabilité de cheville en langue française ont été à l’origine de ce livre, une communauté de vue et amitié ont fait le reste.
Revenir sur la prise en charge en urgence du plus fréquent des traumatismes du membre pelvien que constitue l’entorse de cheville, nous a permis de préciser les séquences diagnostique puis thérapeutique basées sur des critères de gravité dont la synthèse au travers de classifications demeure toujours délicate. Or l’entorse de cheville reste une entité traumatique qui s’accompagne souvent, même chez les patients sportifs, d’un sentiment de bénignité dont le traitement initial est souvent négligé. À l’inverse parfois, diagnostic et traitement initial semblent avoir été parfaitement menés mais n’ont pu empêcher le développement d’une instabilité secondaire.
Considérée comme une complication évolutive des entorses de cheville, l’instabilité chronique est classiquement la plus fréquente avec une incidence estimée à 20 à 40 %. Il s’agit d’un syndrome fonctionnel que l’on peut définir comme la répétition d’épisodes d’instabilité dans un contexte de survenue non véritablement traumatique : de façon caricaturale, le patient se souvient en règle générale du ou des traumatismes initiaux puis qualifie d’« entorses récidivantes » ce qui n’est en fait que la succession d’épisodes d’instabilité survenus dans le cadre de la vie quotidienne (domestique, professionnelle ou sportive).
À cette gêne fonctionnelle d’insécurité d’appui et d’appréhension, peuvent parfois s’associer d’autres symptômes (douleurs, blocages...) donnant le tableau de « séquelles d’entorses » (sprained ankle syndrome) qui semble devenir de plus en plus fréquent. Depuis les travaux de Freeman en 1965, il est classique de différencier deux types d’instabilité : l’instabilité fonctionnelle corrélée à un déficit de contrôle proprioceptif et l’instabilité mécanique corrélée à des lésions ligamentaires déterminant une laxité clinique.
La réalité n’est pas aussi simple, ni les corrélations aussi étroites.
Certes la présence d’une laxité majore le risque d’instabilité, mais une cheville instable peut ne pas être laxe. Tout le problème est de démembrer le symptôme instabilité en termes de syndrome lésionnel. Ainsi faut-il connaître et savoir diagnostiquer les autres causes d’instabilité qui parfois sont aussi associées aux lésions ligamentaires ou la conséquence évolutive de cette instabilité : lésions intra-articulaires (ostéochondrales et syndromes de conflit ou impigement), lésions des tendons fibulaires (tendinopathies fissuraires ou luxations), lésion de la syndesmose tibiofibulaire, pathologie neurologique (pied creux-varus équin, déficit neuromusculaire). Toutes ces étiologies peuvent interférer encre elles et aboutir au concept d’instabilité complexe. La pratique de l’arthroscopie après entorse a montré la fréquence de ces lésions associées.
Une première constatation s’impose, il existe une distorsion entre la fréquence des entorses de cheville et la relative rareté — à la différence du genou — de la chirurgie ligamentaires de stabilisation :
— Y a-il donc des critères, en particuliers morphologiques, pouvant favoriser et expliquer le passage à l’instabilité chronique ?
— Quelle est précisément l’organisation du système ligamentaire de stabilisation collatéral latéral et médial ?
— Quelles sont les contraintes ligamentaires engendrées en fonction du mécanisme lésionnel ?
— Quelle est la part de l’articulation subtalaire ?
Le bilan lésionnel est une étape essentielle du diagnostic qui détermine la conduite thérapeutique. Quels sont désormais les examens complémentaires à programmer ? Le diagnostic de gravité établi, quelle orientation thérapeutique choisir ?
— Y a-t-il encore une place pour la chirurgie dans le cadre des entorses récentes ou de la rééducation au stade d’instabilité chronique ?
— Que faut-il penser du concept de déficit proprioceptif ?
— Si l’indication chirurgicale est posée, que retenir comme principe de reconstruction ?
Telles sont, parmi bien d’autres, quelques questions soulevées dans ce livre !
Notre objectif, en faisant appel à des auteurs de référence que l’on veut chaleureusement remercier ici, a été de présenter tous les aspects de l’instabilité de cheville qui ne se résume pas aux seules lésions ligamentaires...
Puisse-t-il avoir été tenu !
C. Mabit, Y. Tourné
Table des Matières
Liste des auteurs
Préface
Avant-propos
Remerciements
Tablee des compléments en ligne
Abréviations
Chapitre 1 - Bases anatomiques de la stabilité de cheville
Chapitre 2 - Biomécanique et cinématique de la cheville
Chapitre 3 - Épidémiologie des entorses de cheville
Chapitre 4 - Entorses récentes
Approche diagnostique et thérapeutique des entorses latérales
À propos de la cicatrisation ligamentaire
Prise en charge des entorses de cheville : le point de vue de l’urgentiste
Entorses graves de la cheville : quel bilan ?
Diagnostic de gravité des entorses de cheville : à propos des classifications lésionnelles
Entorses graves de la cheville : quel traitement ?
Formes topographiques particulières et leur traitement
Lésions aiguës de la syndesmose tibiofibulaire
Autres entorses : subtalaire et médio-pied
=> Liste des compléments en ligne
Chapitre 5 - Démembrement de l’instabilité chronique
Facteurs d’instabilité
Bilan lésionnel des instabilités chroniques de cheville
Arthroscopie de la cheville et instabilité : mise au point
Les « fausses entorses » de cheville
Instabilité de cheville et troubles posturaux
Chapitre 6 - Traitement médical des instabilités chroniques
Appareillage dans la prise en charge médicale des instabilités chroniques de cheville
Nouvelle approche de la rééducation neuromusculaire dans le traitement de l’instabilité chronique de cheville
=> Liste des compléments en ligne
Chapitre 7 - Traitement chirurgical des laxités chroniques latérales
Laxités chroniques latérales
Techniques alternatives
Place de l’arthroscopie dans le traitement de l’instabilité latérale chronique de la cheville
Que faire face à un échec de ligamentoplastie latérale de la cheville ? Démembrement et propositions thérapeutiques
Instabilité chronique médiale
Lésions chroniques de la syndesmose tibiofibulaire
Autres entorses : « lower sprain » injury
=> Liste des compléments en ligne
Chapitre 8 - Prise en charge des lésions associées et séquellaires
Démembrement des lésions associées et/ou séquellaires à l’instabilité chronique de la cheville
Lésions ostéochondrales du dôme talaire
Tendinopathie des fibulaires et instabilité de cheville
Arthrose
Chirurgie secondaire dans l’arthrose sur instabilité de cheville : place respective de l’arthrodèse et de l’arthroplastie totale
Notions d’instabilité complexe de la cheville
=>Liste des compléments en ligne
Chapitre 9 - Prise en charge des instabilités neuromusculaires
Instabilité de cheville et brièveté des gastrocnémiens
Instabilité chronique de cheville d’origine neurologique
=>Liste des compléments en ligne
Chapitre 10 - Entorse de la cheville de l’enfant et de l’adolescent et instabilité post-traumatique
=> Liste des compléments en ligne
Chapitre 11 - Scores d’évaluation de la cheville instable à l’usage du clinicien
=> Liste des compléments en ligne
Chapitre 12 - Existe-t-il un traitement préventif des entorses de cheville ?
Index